
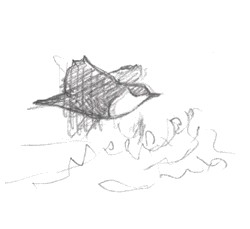
par Jean-Luc BRIOT
Présenter succinctement les oiseaux qui fréquentent le bord de
nos rivières me paraît superficiel et peu enrichissant. Il me semble
plus intéressant d'aborder en détail la biologie d'une espèce
particulière, telle que le décrivait si bien un ornithologue Suisse,
Paul Géraudet, dans "la Vie des Oiseaux", éditée
dans les années 1950.
Les lignes qui suivent sont extraites de ses ouvrages sur les Passereaux d'Europe, corrigées et complétées par des études récentes.
Commençons donc par une espèce curieuse et sympathique très fréquente sur les bonnes rivières à truites : le Cincle Plongeur.

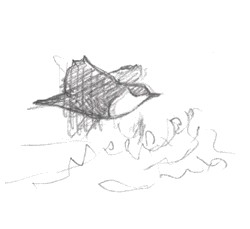
LE CINCLE PLONGEUR OU MERLE D'EAU

Au-dessous de la cascade, sur une grosse pierre aspergée de poussière
d'eau et balayée d'écume, le Cincle surveille le courant. Trapu,
rondelet, il est à peu près de la taille d'un Merle, auquel il
ressemblerait davantage s'il n'avait une queue aussi courte ?, il paraît
noir ou ardoisé, avec une superbe bavette d'un blanc éclatant
qu'on repère de loin. C'est le seul Passereau plongeur et nageur. Le
voici sur une pierre au milieu de l'eau, tout agité de tics nerveux,
de rapides courbettes sur ses pattes à ressort, abaissant sa queue à
petits coups, "clignant" des yeux à tout instant. Soudain il
descend dans l'eau, s'immerge à demi ou en entier, sans hésitation,
et sort un peu plus loin sur une petite grève.
L'habileté de sa technique en toute situation, nous stupéfient lorsque nous avons l'occasion rare de l'observer dans de bonnes conditions. Tantôt le Cincle arrête son vol et se laisse choir comme une pierre, ce qu'il fait aussi d'un perchoir, en plongeant délibérément ; tantôt, de la rive où il pataugeait, il pénètre dans l'eau en poursuivant sa marche. Plus souvent encore, il nage en surface, pique de ci, de là, quelques insectes en pivotant légèrement, ou bien "lorgne" en immergeant la tête. Tout à coup, il s'enfonce, puis reparaît quelques secondes plus tard à peu de distance du point d'immersion, en aval ou en amont. Aux eaux stagnantes, il préfère les remous, les tourbillons, les rapides écumants, et même les cascades qu'il traverse sans hésiter.
La technique du déplacement sous l'eau est assez bien connue. Plongeant dans le courant, l'oiseau atteint le fond en s'aidant des ailes, des pattes et de la queue, utilisée comme gouvernail ? puis? il marche sur le lit de la rivière, contre le courant, penché en avant, le dos oblique, tandis que le bec pique des proies ou fait culbuter de petites pierres. Selon que le courant est plus ou moins fort, il maintient son équilibre en entrouvrant et refermant les ailes ou par de petits coups de balancier. Son plumage fin et serré retient une fine pellicule d'air qu'on voit briller par moments autour de son corps ; aucune plume ne se mouille, car le Cincle procède avec soin à la toilette de son plumage ; la glande uropygienne qui permet de graisser son plumage est 6 à 10 fois plus grosse que chez les autres passereaux.
La plongée est brève 4 à 7 secondes, parfois jusqu'à 15. L'oiseau remonte sans effort, comme un bouchon, les ailes à demi ouvertes. On l'a vu marcher à reculons en descendant le courant, et il ne semble pas se cramponner particulièrement aux pierres du fond avec ses ongles robustes.
La fréquence des plongeons peut atteindre en moyenne 5 à la minute et, en Asie, on a constaté qu'un Cincle peut plonger en moyenne 1600 fois par jour, et ainsi passer plus de deux heures sous l'eau. Il s'enfonce jusqu'à 1,50 m (maximum) et, sans difficulté, trouve sa nourriture dans un courant de 40 à 60 cm/seconde.
Le régime a fait l'objet de nombreuses études depuis que fa pollution des ruisseaux et torrents a augmenté et que leur degré d'acidité s'est élevé. En effet, le Cincle dépend presque totalement de la productivité des cours d'eau, car les insectes capturés sur leurs berges ont généralement des larves aquatiques.
On pourrait croire que le Cincle mange beaucoup de petits poissons et de frai, et les pêcheurs le persécutent souvent sur cette présomption. De multiples analyses démontrent que c'est avant tout un insectivore qui capture une foule de larves et d'insectes aquatiques : Coléoptères, phryganes, éphémères, notonectes, ainsi que des crustacés (gammares) et de petits mollusques. À ces aliments principaux s'ajoutent des vers, des sangsues, quelques petits poissons (jusqu'à 6 cm de longueur, en particulier des chabots) et des substances végétales. Le Cincle n'est donc pas un danger pour les truites, dont il n'est que le commensal, et il peut parfaitement prospérer sur des rivières sans poissons.
Le Cincle plongeur est l'hôte typique des cours d'eau rapides et limpides, coulant sur un lit de graviers ou de roc. Le voisinage des barrages, des scieries, des moulins et des ponts est particulièrement apprécié pour les sites, propices à la construction du nid. Il remonte le long des torrents clairs jusqu'à l'altitude de 2200 m pour nicher. Les petits lacs reçoivent aussi sa visite et il s'y reproduit parfois. Jusqu'ici, seule la le chassait des cours d'eau ?, maintenant il s'y ajoute la pollution, dont l'effet est définitif : il n'y a plus de faune aquatique dans ces égouts bétonnés et les Cincles les ont abandonnés.
Revenons à la belle rivière libre et propre, où nos " Merles d'eau " ont chacun leur territoire hivernal, un secteur variant entre 200, ou 1 km de longueur. E n'est pas rare d'y assister à des disputes, à des violations de frontières, d'y entendre chanter les oiseaux. Dès janvier, les couples se forment ou renouent leurs liens, chassent les voisins trop proches afin d'agrandir le domaine commun. C'est surtout en février et en mars, puis durant toute la période de nidification, que se placent les manifestations amoureuses. Les deux oiseaux s'agitent beaucoup, vibrent des ailes ou les relèvent au-dessus du dos, se font des révérences innombrables, se poursuivent en volant à une hauteur inaccoutumée et en chantant, se querellent, sautent l'un contre l'autre, se battent à coups de bec, ou bien le mâle offre un insecte à sa compagne... bref c'est une vie trépidante, même pendant le nourrissage des petits. La bigynie (un mâle ayant simultanément deux femelles) a été observée plusieurs fois. Le nid est un ouvrage vo1umineux~et solide, pareil à celui que ferait un Troglodyte géant ; d'habitude, les deux adultes travaillent ensemble à construire au moins la partie externe, le nid interne étant l'oeuvre de la femelle. On le trouve toujours au-dessus de l'eau. Dans une cavité quelconque d'un mur ou d'un rocher. Souvent le nid est situé à l'air libre, soit suspendu dans un enchevêtrement de racines, posé sur une saillie, une outre ou une poutrelle de pont, soit appliqué contre une muraille et soutenu par une plante, ou même derrière la nappe d'eau d'une cascade, grâce à sa structure très serrée faite de mousse, il peut être utilisé pour une deuxième ponte, réparé, il sert encore l'année suivante, car les Cincles sont très attachés au site de leur choix.
Dans la seconde quinzaine de mars, 5 oeufs blancs sont déposés, que la femelle seule couve. Bien que son compagnon lui offre parfois la becquée, elle sort fréquemment pour se nourrir elle-même. L'incubation dure 15 à 18 jours. Les petits se signalent vite par des cris aigus, quand un des deux parents arrive avec le bec plein de proies ; celles-ci sont en général " lav&??s " avant d'être apportées. Les adultes s'efforcent de maintenir. la propreté du nid, au moins à l'intérieur, qui reste étonnamment sec. Le séjour de la nichée est plutôt long : 19 jours en moyenne, parfois jusqu'à 25 ; à leur sortie, les jeunes Cincles se jettent directement à l'eau, savent nager et plonger avant de voler, et se cachent le long des rives, où les parents viennent les nourrir. Quatre à cinq semaines plus tard, ils quittent le secteur. Une seconde ponte est produite dès le milieu de mai, même 5 à 10 jours déjà après l'envol de la première nichée.
Une fois indépendant, les jeunes se dispersent au hasard, remontant ou descendant la rivière et parvenant dans les cours d'eau voisins, sans toutefois s'éloigner beaucoup, rarement au?delà de 50 km. Dès juillet Août, les Cincles de l'année cherchent à se fixer dans un territoire, le premier qu'ils trouvent libre. Il s'ensuit à cette époque; et jusqu'en octobre au moins, un mouvement assez général, où l'on verrait facilement l'effet d'une migration. A cela s'ajoutent les déplacements des Cincles montagnards, qui descendent quand les eaux gèlent pour hiverner en plaine. Cependant, une bonne partie des Cincles sont sédentaires et très fidèles à leur secteur de rivière.
Jean-Luc BRIOT